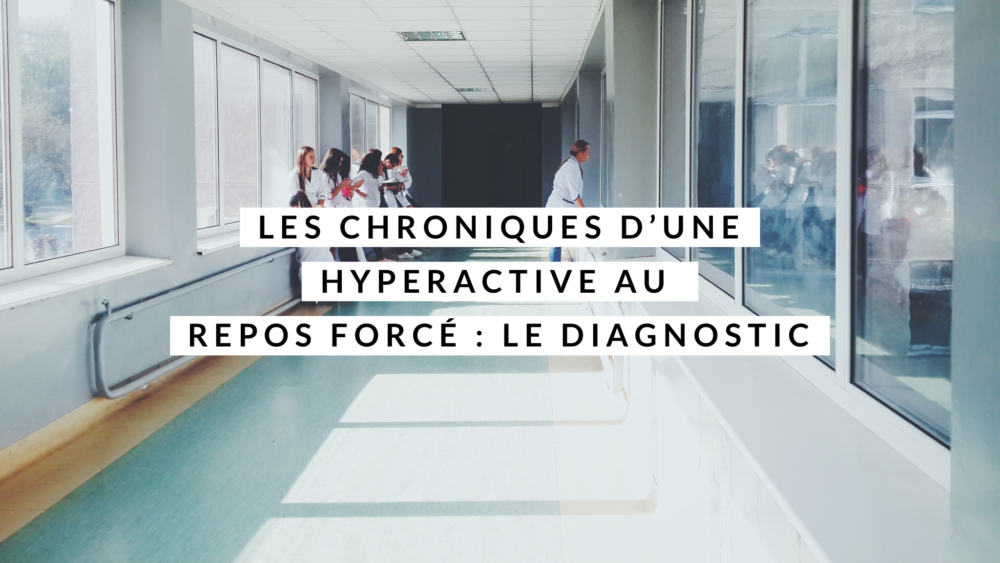Pour lire la première partie, c’est ICI.
La douleur est maintenant constante, j’ai la cheville qui brûle, je ne retiens presque plus mes larmes, elles coulent malgré moi.
Les voitures avancent à pas de tortue dans la congestion typique du lundi matin multipliée par 10 à cause de la neige. La maman (j’ignore son prénom alors que je m’occupe de sa fille 5 jours par semaine !) qui m’accompagne se veut rassurante. On apprend un peu à se connaître, la situation permettant quand même un peu de small talk étant donné la lenteur du système routier.
Mon cerveau spin déjà à 150 km/h. Je pense à mon travail, à ma voiture restée à la garderie, à ma patronne qui devait déjà multiplier les téléphones pour me trouver une remplaçante. À mon chum qui a dû laisser son travail en plan pour me rejoindre.
Une fois devant les portes de l’urgence, mon aidante naturelle (elle s’appelle Magy, je l’apprendrai de ma patronne, quand je lui ai demandé ses coordonnées pour la remercier) va chercher un fauteuil roulant avant de me confier aux bons soins de la dame du triage à l’accueil, en attendant la venue imminente de mon chum.
Après à peine 10 minutes d’attente, je suis immédiatement appelé par l’infirmière qui doit prendre connaissance de ma situation et décider du niveau de priorité que l’on accordera à mon état. Mon chum n’est même pas encore à mes côtés, une gentille bénévole me roule jusqu’au local. À peine 10 minutes, dans le système de la santé québécois engorgé que l’on connaît, c’est un très bon temps.
Il ne faut que quelques secondes à l’infirmière pour saisir l’étendue des dégâts causés par ma chute. Le bandage maison, fait à la garderie, n’est pas assez gros pour cacher ce qu’elle semble détecter tout de suite : ma cheville est croche.
Ce que je pensais être de l’enflure est plutôt une torsion qui semble me déformer le pied.
Je suis sous le choc.
L’infirmière ne se proclame ni médecin ni radiologue, mais elle sait que je devrai voir les deux dans un avenir rapproché. Elle m’offre deux Tylenols au moment où mon chum me rejoint dans le local.
Un rapide échange de regards entre les deux me fait comprendre qu’il détecte la même chose.
Je suis très mal en point.
Je reprends ma place dans la salle d’attente. Je ne connais pas mon code de priorité. Mon petit doigt et le fait que la salle soit étonnamment vide me disent que ce ne sera peut-être pas aussi long que ça pourrait l’être.
Je me prépare quand même pour de longues heures à ressentir de la douleur et à prendre mon mal en patience parce qu’il y a des cas sans doute plus urgents que le mien qui risquent d’attirer l’attention du personnel hospitalier.
Si les planètes de la malchance avaient jeté leur dévolu sur moi à 7 h ce matin-là, celles de la chance ont rapidement pris le relais vers 9 h 30 puisqu’en moins de 2 heures j’avais vu un médecin, qui n’a fait ni une ni deux et m’a rapidement envoyé en radiologie après avoir remarqué la courbe désormais anormale de ma cheville, et j’étais passé sous les rayons X et j’avais revu le médecin qui a rapidement établi un diagnostic.
Fracture de la cheville.
Aussi banal que ça.
Restait juste à faire un demi-plâtre, effectué en moins de 15 minutes. J’ai dû certainement battre des records de temps ce matin-là, la moyenne étant généralement beaucoup plus longue à ce qu’on m’a dit.
J’ai obtenu mon congé avec un papier stipulant un arrêt de travail de minimum 4 semaines pour l’instant.
Minimum 4 semaines, ça veut dire que je pourrais être rétablie autour du 17 décembre.
Juste à temps pour Noël.
L’orthopédiste allait me contacter d’ici la fin de la semaine pour me dire si on devait effectuer une chirurgie afin de réparer le tout.
Ok, il y a une chance que ça se répare tout seul cette affaire-là ? Ça serait ben l’fun que je puisse étirer ma chance de malchanceuse en évitant de passer sous le bistouri.
Surtout après avoir googlé fracture de la cheville. Je le sais, il ne faut pas faire ça.
Google est ton ennemi quand il est question de lui demander des infos sur ta santé.
Contente-toi de lui demander l’heure qu’il est en France ou de mettre une playlist des années 90.
Je retourne à la maison, la cheville bien bandée, un peu épuisée par les émotions.
J’ai mon fils et mon chum à mes côtés, aux petits soins avec moi à la suite de ce début de semaine mouvementé. Je me couche en croisant les doigts bien forts pour éviter l’opération et j’espère me réveiller le lendemain pour réaliser que ce n’est qu’un cauchemar.
Après une nuit difficile où j’ai peiné à trouver une position confortable pour dormir, c’est à 8 h tapante que je reçois l’appel tant redouté.
La secrétaire de l’orthopédiste me demande de venir immédiatement le rencontrer. Elle me demande si je suis à jeun, ce que je lui confirme, ayant pris mon dernier repas à 18 h la veille.
J’ai peur. Je suis carrément terrorisée.
On n’appelle pas quelqu’un en lui demandant de se présenter à jeun à l’hôpital pour lui annoncer qu’elle n’a pas besoin d’une opération.
Il neige encore, mon chum et moi prenons la route en nous demandant ce qui m’attend même si moi, je ne suis guère optimiste.
Une fois sur place, c’est beaucoup plus bondé que la veille. Je tombe même sur un couple d’amis de mes parents venus justement rencontrer le même orthopédiste que moi. Ils ne tarissent pas d’éloges à son sujet d’ailleurs.
Une fois dans son bureau, le verdict tombe.
Double fracture de la malléole.
Une opération est nécessaire pour insérer des vis et des plaques, afin de remettre ma cheville droite. Interdiction de mettre du poids sur ma jambe pour 6 à 8 semaines, le double du temps d’arrêt décrété par le médecin la veille.
Mon cœur se met en état de panique.
Mais ce n’est pas l’opération qui me met dans cet état cette fois-ci. Ni la perspective de devoir subir des traitements de physiothérapie ou la possibilité de souffrir d’arthrose prématurée.
C’est l’inactivité prescrite pour un minimum de 6 à 8 semaines.
Une I-N-A-C-T-I-V-I-T-É complète pour presque 2 mois.
On est le 20 novembre. Il reste 35 jours avant Noël.
Moins de deux mois.
J’ai fait le calcul assez vite.
Et j’ai pleuré. En sortant du bureau de l’orthopédiste, pendant que mon chum poussait mon fauteuil roulant vers l’ascenseur qui allait m’amener à l’étage de chirurgie d’un jour.
Parce qu’on ne niaise pas avec mon cas, je vais passer entre les mains du chirurgien dans quelques heures à peine.
Et devenir inactive pour 2 mois. À la merci des autres qui voudront bien m’offrir leur aide. Moi qui me débrouille toute seule depuis 36 ans.
Je pense à mon film préféré, à sa réplique légendaire.
Et je me l’approprie.
« On ne laisse pas une hyperactive dans un coin. »
À suivre…